
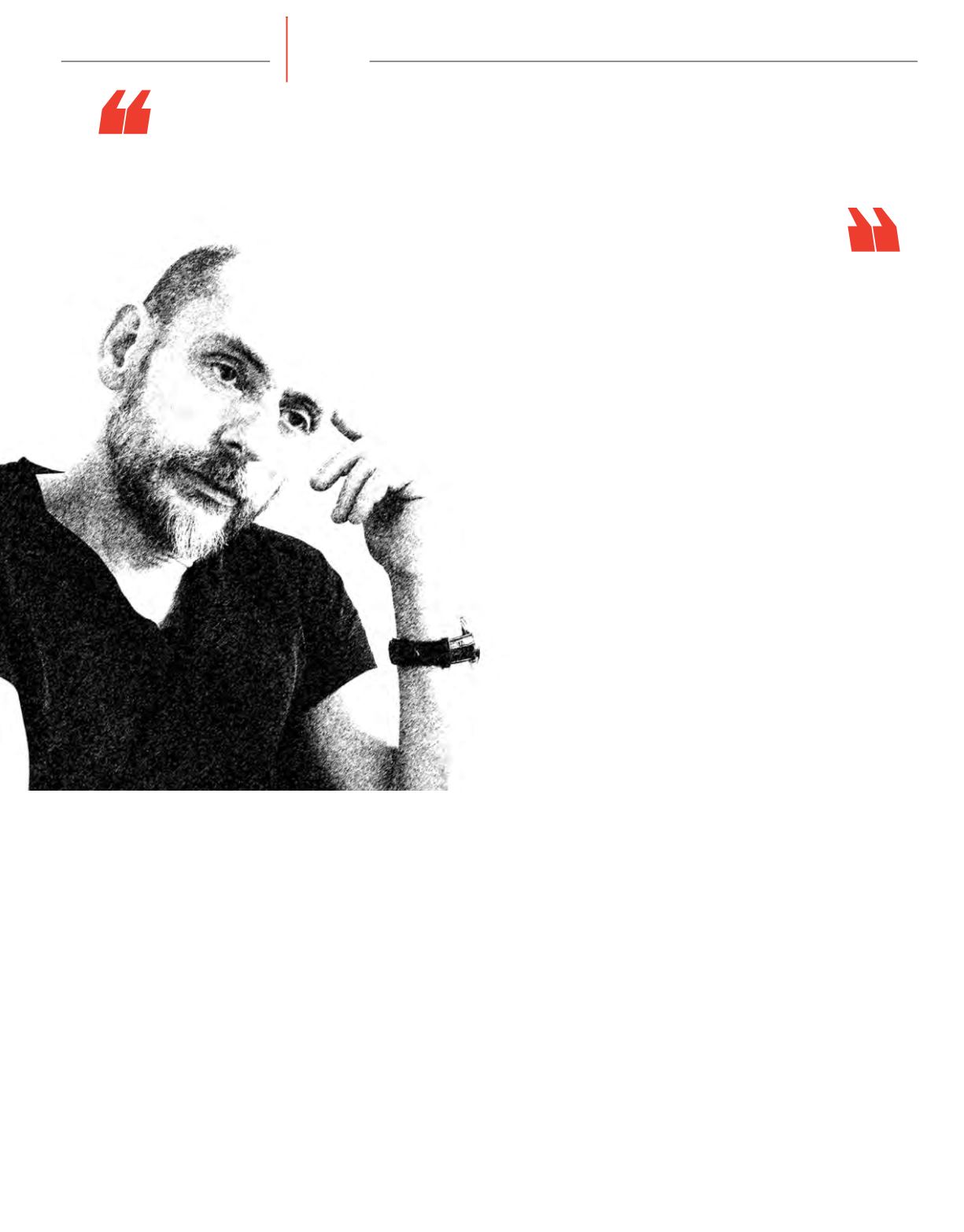
|
HDS
mag
|
n°46 - mars-avril 2016
2
L’évolution, Darwin, la sélection naturelle…
Dans
L’Évolution, question d’actualité ?
, Guillaume
Lecointre, professeur au Muséum national d’histoire
naturelle, revient sur plusieurs idées reçues.
maga z i ne
La biodiversité
finira par repartir
HDS
Le premier malentendu vient du mot « évolution ».
Quelle est sa définition ?
GL
Il est gênant en sciences d’utiliser un mot du langage courant.
C’est le problème avec « évolution » qui, dans le langage de tous les jours,
signifie souvent « aller vers du mieux » comme quand on dit à quelqu’un
qu’il faut qu’il évolue. En sciences, l’évolution désigne le processus
par lequel le vivant change et se maintient tout en changeant.
HDS
D’où votre expression « la régularité malgré
le changement »…
GL
L’évolution, et plus précisément la sélection naturelle, le mécanisme
que l’on doit à Darwin, expliquent en effet la régularité des espèces malgré
le changement. C’est quelque chose qui n’est pas facile à comprendre
car c’est une question d’échelle d’observation. Ce qui est régulier à
nos yeux provient d’un jeu d’essais-erreurs qui se fait au hasard et que
nous ne voyons pas. Dans la nature, ce qui marche est le résultat d’un
long processus où des millions d’individus multipliés par des millions
de générations ont essayé une multitude de « solutions » dont beaucoup
n’ont pas fonctionné et se sont éteintes. La résultante, la moyenne à
grande échelle, triée par l’environnement, est ce qui fonctionne et que
l’on perçoit alors comme régulier. C’est contre-intuitif pour nous, les
hommes, car nous aimons bien que ce que nous percevons comme une
« harmonie », l’adéquation entre les formes et les fonctions, soit dû à une
volonté.
HDS
La théorie de Darwin est souvent résumée à l’expression
« struggle for life », la lutte pour la vie. Encore une idée fausse ?
GL
Darwin utilisait bien cette expression. Mais quand on lit son texte,
on s’aperçoit que « struggle » doit se comprendre comme « effort » et
non comme le « combat » de tous contre tous. La lutte pour la vie, c’est
l’ensemble des actes qui maintiennent en vie, qui maintiennent la vie :
s’abriter, se réchauffer, capter des ressources, les partager, séduire un
partenaire sexuel…
HDS
Vous évoquez le partage des ressources. L’évolution n’est
donc pas seulement compétitive ?
GL
Non, il y a aussi beaucoup d’entraide. Les populations qui coopèrent
font plus de petits que celles qui ne coopéreraient pas dans les mêmes
conditions. De plus, tous les êtres vivants sont parasités jusqu’à arriver
à des situations de mutualisme, c’est-à-dire de coopération à bénéfice
équilibré. Le zèbre laisse l’oiseau pique-bœuf picorer son pelage. Ainsi
le zèbre se débarrasse des parasites et l’oiseau se nourrit. Nous sommes
tous des intrications vivantes. Nous-mêmes ne pourrions pas digérer
sans notre flore intestinale qui est composée de milliards de cellules qui
appartiennent à une autre espèce que nous.
HDS
Qu’en est-il alors de l’expression « la survie du plus apte » ?
GL
C’est une formule tellement courte qu’on n’y comprend plus rien.
Le grand public pense parfois qu’il s’agit de la survie du plus adapté.
Or l’aptitude n’est pas l’adaptation. L’aptitude est une qualité individuelle :
aptitude à parler anglais, à courir vite… Alors que l’adaptation est la
stabilisation d’une ou plusieurs variations favorables dans la population,
c’est un acquis populationnel. Maintenant, il s’agit de savoir apte à quoi…
Comment mesure-t-on le succès d’une variation dans un lignage ? C’est en
terme de fréquence. Ce qui veut dire que la reproduction est passée par
là. On parle donc de l’aptitude à se reproduire. Un variant qui n’apporte
aucune aptitude à se reproduire ne va pas nécessairement se maintenir.
Alors qu’un variant va accélérer son expansion s’il se traduit comme
un avantage en termes de nombre de petits potentiels.
















